Comment la Chine est devenue le talon d’Achille de ces 22 grandes marques
Ces marques célèbres en chute libre en Chine

Autrefois perçue comme un marché de rêve au potentiel colossal, la Chine s’est muée en cauchemar commercial pour de nombreuses marques étrangères. Des géants de la tech aux compagnies aériennes en passant par les maisons de luxe, plusieurs acteurs majeurs de l’économie mondiale affrontent aujourd’hui une zone de turbulences sans précédent, alimentée par un faisceau de facteurs défavorables.
Découvrez pourquoi la Chine représente désormais un défi stratégique pour ces mastodontes de la consommation et quelles marques en paient le plus lourd tribut. Tous les montants indiqués sont en dollars américains, sauf mention contraire.
Adaptation française par Aurélie Blain et Laëtitia Lord
Les marques étrangères font face à de multiples obstacles

En Chine, les marques étrangères sont confrontées à des difficultés venant de toutes parts. L’économie chinoise étant en perte de vitesse, les consommateurs ont resserré les cordons de la bourse. Avec une croissance atone, une crise sévère du marché immobilier et un taux de chômage élevé chez les jeunes, la confiance est en berne et les dépenses sont en recul dans tous les secteurs, en particulier pour les achats non essentiels.
La montée en puissance des marques locales représente un défi majeur pour les entreprises étrangères. Plus compétitives sur les prix, les entreprises chinoises séduisent de plus en plus une clientèle soucieuse de son budget, rendant la concurrence encore plus féroce pour les acteurs internationaux.
Tensions géopolitiques et autres difficultés

Comme si le ralentissement économique et la concurrence acharnée des marques locales ne suffisaient pas, les entreprises étrangères doivent désormais composer avec un obstacle supplémentaire de taille : l’escalade des tensions géopolitiques entre la Chine et l’Occident, qui pèse lourdement sur leurs activités.
Depuis le déclenchement par Donald Trump d’une guerre des droits de douane contre la Chine, une série de représailles de Pékin a suivi. Cette guerre commerciale qui reste vive continue de freiner les échanges internationaux et attise un sentiment anti-occidental croissant en Chine.
Alimenté par un nationalisme en plein essor, ce rejet pousse de nombreux consommateurs à délaisser les marques étrangères au profit d’acteurs locaux. Certaines enseignes emblématiques ont même été la cible de vastes campagnes de boycott.
Sponsored Content
La tendance nationaliste et le « luxury shaming »

Cette tendance porte un nom : Guochao, qui signifie « marée nationale » et que l’on appelle aussi « China Chic ». Particulièrement populaire au sein de la génération Z et des Millennials chinois, elle reflète une préférence croissante pour les marques, l'art et la culture nationaux.
Autre problème complexe pour les marques étrangères, notamment celles du secteur du luxe, le rejet ostensible des signes extérieurs de richesse et des marques voyantes, qui sont désormais perçus comme décadents et vulgaires. De nombreuses grandes marques ont quitté le marché chinois ces derniers temps et la situation s'annonce de plus en plus sombre pour celles qui restent...
Samsung

Prenons l’exemple de Samsung. Le géant sud-coréen de l’électronique est devenu le leader mondial du smartphone après avoir dépassé Apple l’an dernier. Pourtant, en Chine, sa part de marché a chuté en flèche. Son modèle phare, le Galaxy, représente désormais moins de 5 % des ventes, tandis qu’en janvier, la marque chinoise Huawei est devenue le numéro un des ventes dans le pays, suivie par une autre marque locale, Vivo.
Cette concurrence locale féroce et le coût élevé des appareils Samsung expliquent en partie ce déclin, d’autant plus que les subventions gouvernementales chinoises pour l’achat d’électronique sont limitées aux modèles d’entrée de gamme. Mais la géopolitique joue également un rôle majeur. Comme le rapporte le site spécialisé DigiTimes Asia, Samsung a été victime des boycotts visant les entreprises sud-coréennes, conséquence du déploiement controversé d’un système américain de défense antimissile en Corée du Sud en 2016.
Le géant de l’électronique a également souffert de la campagne patriotique « Buy Chinese » lancée en 2020 lorsque les relations entre la Chine et les États-Unis se sont détériorées.
Qantas

Les compagnies aériennes occidentales désertent la Chine en masse. En mai dernier, Qantas a jeté l’éponge en annonçant la suppression de sa seule liaison avec la Chine continentale, la ligne Sydney-Shanghai.
Lancée en 2004 avec un grand optimisme, cette route avait connu son âge d’or à la fin des années 2010, période durant laquelle la compagnie australienne exploitait également des vols vers Pékin et proposait d’autres liaisons en partenariat avec des compagnies chinoises. Pas plus tard qu’en 2017, Qantas assurait encore 14 vols hebdomadaires vers la Chine.
Cependant, la demande s’est effondrée pendant la pandémie de COVID-19 et ne s’est jamais rétablie en raison du ralentissement économique chinois. Selon le site spécialisé AirlineGeeks, les tensions géopolitiques et certaines erreurs stratégiques auraient contribué au retrait de Qantas, en plus de la décision du régulateur australien d'empêcher la compagnie de renouveler son contrat avec son dernier partenaire local.
Sponsored Content
Virgin Atlantic

Virgin Atlantic a suivi la tendance générale en juillet 2024, mettant fin à 25 ans de service entre l’aéroport londonien d’Heathrow et Shanghai, invoquant des « défis et difficultés importants ». La compagnie aérienne a enregistré des pertes de 178 millions de dollars (164 millions d’euros) en 2023 et la mauvaise performance de la ligne chinoise a probablement contribué à ce déficit. Virgin avait déjà supprimé sa liaison avec Hong Kong l’année précédente, mettant ainsi fin à près de 30 ans d’exploitation sur cette route emblématique.
Comme la plupart des transporteurs européens, la compagnie aérienne de Richard Branson ne peut plus survoler l’espace aérien russe, ce qui rallonge les trajets vers la Chine et les rend plus coûteux. Les compagnies aériennes chinoises, quant à elles, peuvent toujours survoler la Russie, ce qui leur confère un avantage concurrentiel considérable. Il n’est donc pas surprenant que les compagnies aériennes occidentales ferment leurs lignes. Scandinavian Airlines a également cessé complètement ses opérations en Chine, tandis que Lufthansa et British Airways ont réduit considérablement leurs services.
Estée Lauder
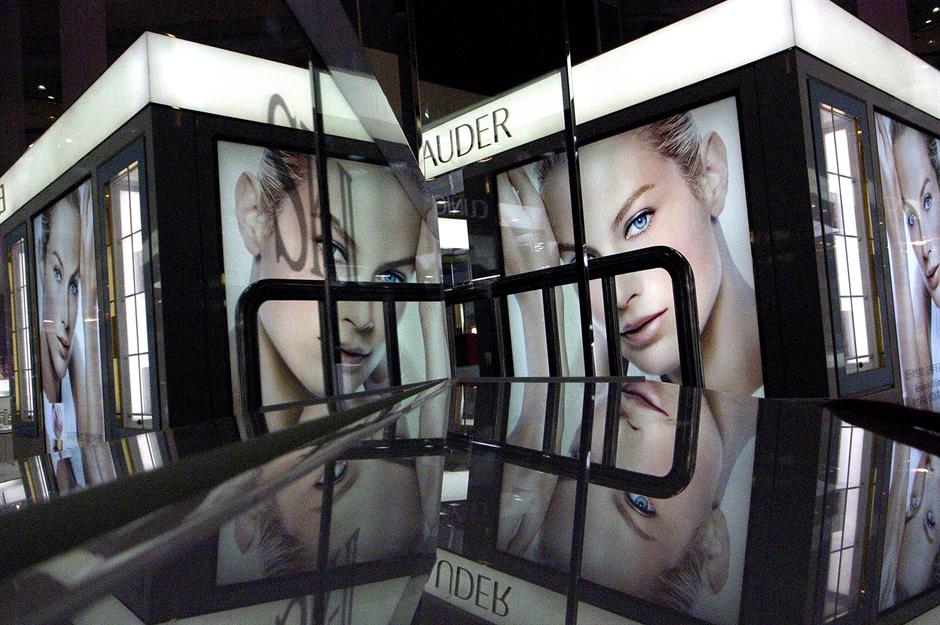
La Chine est le deuxième plus grand marché de la beauté au monde, derrière les États-Unis, mais les marques de prestige étrangères peinent à y maintenir leur position. Face à des consommateurs en quête d’économies, les achats de produits haut de gamme diminuent, tandis que les marques locales de C-Beauty, plus abordables et adaptées au marché chinois, connaissent un véritable essor.
Selon le site d’information The China Academy, pas moins de 20 marques cosmétiques étrangères ont quitté la Chine ces dernières années, faute de ventes suffisantes. Parmi elles, on retrouve Maybelline et Innisfree.
Estée Lauder, elle, reste en place, mais son groupe, qui détient également Clinique, MAC et d’autres grandes enseignes, a dû réviser à la baisse ses prévisions de ventes en raison de la faible demande en Chine. Désormais, l’entreprise mise davantage sur le marché de masse que sur le luxe, avec notamment l’introduction récente de sa marque scientifique The Ordinary. Un pari stratégique qui reste à confirmer.
Shiseido

La marque de beauté japonaise Shiseido traverse également une période difficile. La faiblesse du marché du duty-free due au manque de confiance des consommateurs ne fait qu’aggraver la situation. Sur un an, ses profits ont chuté de 73 %, passant de 28 milliards de yens japonais (170 millions d’euros) à seulement 7,6 milliards (50 millions d’euros) à la fin décembre.
Son activité en Chine a enregistré un recul de près de 5 % sur l’année et la tendance devrait encore s’aggraver cette année.
La situation de Shiseido est d’autant plus critique qu’elle subit de plein fouet un boycott des produits japonais par les consommateurs chinois. Cette réaction a été déclenchée par le rejet en mer d’eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima en 2023. Depuis, les ventes ont chuté brutalement et peinent à se redresser.
Sponsored Content
Starbucks

Depuis l’ouverture de sa première enseigne en Chine en 1999, Starbucks a été l’un des moteurs du changement, contribuant à faire évoluer le pays d’une culture exclusivement tournée vers le thé vers un véritable marché du café. Aujourd’hui, avec plus de 7 000 établissements, la Chine est le deuxième marché le plus important de l’enseigne après les États-Unis. Pourtant, son activité y connaît un net ralentissement, avec des ventes en baisse de 8 % sur l’exercice 2024.
Positionné sur une offre haut de gamme, Starbucks reste plus cher que ses concurrents malgré une guerre des prix acharnée avec son rival chinois Luckin Coffee. Et ce dernier semble l’emporter : à la fin 2024, Luckin Coffee comptait trois fois plus de points de vente que la chaîne américaine.
Face à ces défis, Starbucks cherche désormais à s’associer avec un partenaire local, espérant mieux comprendre les spécificités du marché chinois et redresser la barre.
Vous aimez ce contenu ? Ajoutez un like et cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d'autres articles de loveMONEY.
Pandora

La marque de joaillerie danoise Pandora régnait sur le marché chinois à la fin des années 2010. En 2019, le plus grand bijoutier au monde en volume réalisait un chiffre d’affaires de 283 millions de dollars (258 millions d’euros) en Chine, soit 9 % de ses revenus mondiaux. Mais depuis, les ventes ont chuté drastiquement, avec une nouvelle baisse de 10 % en 2024. Désormais, Pandora ne représente plus qu’1 % du marché chinois.
Face à cette érosion, la marque prévoit de fermer 50 boutiques sur près de 200 dans le pays.
Son principal problème ? Pas assez prestigieuse pour rivaliser avec les grandes maisons de luxe et pas assez abordable pour concurrencer les marques locales. Par ailleurs, les consommateurs chinois, en particulier la génération Z, boudent ses bracelets en argent sterling au profit de bijoux en or, notamment sous forme de petites fèves, prisées comme investissement sûr en période d’incertitude.
Selon Jing Daily, Pandora s’est aussi dispersée dans une avalanche de lancements de produits, perdant son attrait en submergeant les clients d’un excès de choix. À cela s’ajoute une stratégie marketing mal calibrée : en misant trop sur des collaborations avec Disney et Marvel, la marque a fini par éloigner une clientèle plus âgée.
Nike

Les ventes de Nike en Chine ont augmenté de 6 % sur un an jusqu’au troisième trimestre 2024, mais le géant du sportswear voit sa part de marché menacée par des marques locales ultra-agiles, comme Anta et Li-Ning. Ces dernières surfent sur la tendance Guochao, qui valorise les marques nationales et séduit de plus en plus les consommateurs chinois.
D’après une analyse de la banque suisse UBS, Nike ne devrait pas enregistrer de performances remarquables en Chine à court terme. La marque devrait connaître une croissance lente, avec peu de marge de rebond au cours des prochaines années.
Mais Nike ne compte pas se laisser faire. Pour contrer cette offensive, la marque a mis en place plusieurs initiatives stratégiques, dont l’ouverture d’un flagship spectaculaire à Pékin, des collaborations exclusives réservées au marché chinois, ainsi que la tenue de son deuxième événement Nike On Air à Shanghai l’an dernier.
Sponsored Content
Esprit

Les marques occidentales de fast-fashion et de prêt-à-porter milieu de gamme souffrent en Chine, alors que les consommateurs soucieux de leur budget privilégient des alternatives locales moins chères, comme Shein et Taobao, dans le sillage de la tendance Guochao.
La marque d'origine américaine Esprit prévoit une perte de 150 millions de dollars (137 millions d’euros) en 2024, après un déficit de 298 millions de dollars (272 millions d’euros) l’année précédente. Déjà fragilisée en Europe où elle a récemment déposé le bilan, la marque peine encore plus sur le marché chinois, au point que sa maison mère cherche à revendre l’intégralité de ses activités en Grande Chine, selon les sites spécialisés Just Style et FashionUnited.
ASOS
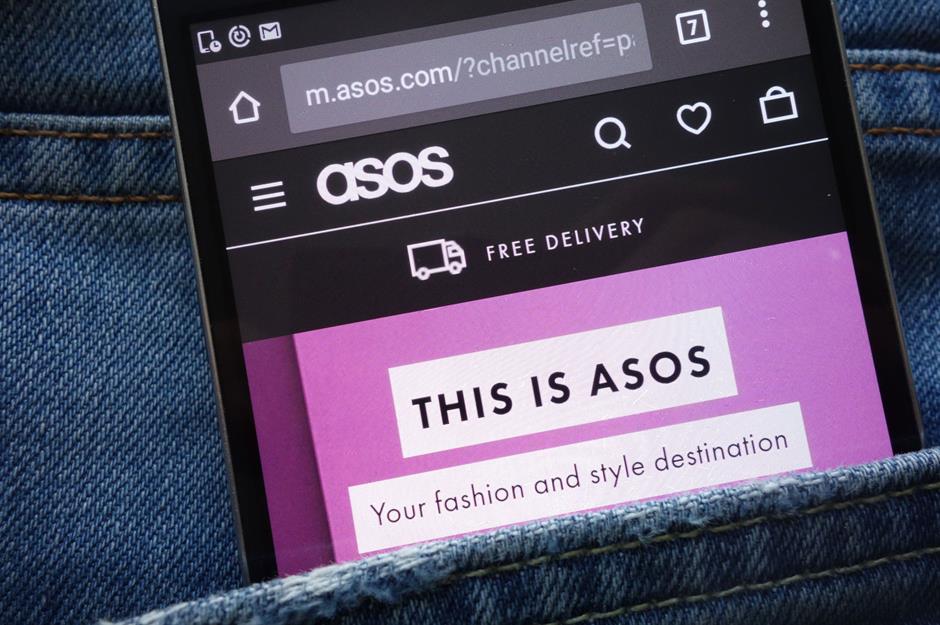
L’aventure d’ASOS en Chine a pris fin rapidement en 2016, avec la fermeture par la marque britannique de mode en ligne de son entrepôt de Shanghai et son retrait du marché chinois. Le manque de notoriété de la marque et la concurrence féroce d’Alibaba et autres rivaux locaux ont contribué à cet échec. Même si ASOS n’opère plus en Chine, l’entreprise doit affronter un problème de taille : Shein.
Le géant chinois de la fast-fashion, qui a doublé ses bénéfices l’an dernier, s’empare des clients de la génération Z d’ASOS et grignote ses parts de marché.
D’après les analystes de Global Data, il devrait dépasser ASOS pour devenir le sixième plus grand détaillant de vêtements au Royaume-Uni dès 2027, reléguant ainsi son rival britannique à la dixième place.
Louis Vuitton

Les marques de luxe ne sont pas épargnées. Dans un contexte économique morose, les consommateurs chinois achètent certes moins d’articles coûteux, mais une autre tendance inquiète les PDG de ces entreprises : la « honte du luxe ».
Pékin a lancé une campagne anti-ostentation, bannissant notamment les influenceurs de mode les plus tape-à-l’œil des réseaux sociaux. Afficher sa richesse est désormais mal vu. En parallèle, la montée de la tendance Guochao renvoie de plus en plus les consommateurs chinois vers les marques de luxe locales. LVMH, qui possède Louis Vuitton, Dior et de nombreuses autres marques très haut de gamme, en subit les conséquences. Ses ventes en Asie (hors Japon), qui représentent près d’un tiers de ses revenus mondiaux, ont chuté de 11 % l’année dernière.
Autre coup dur pour Louis Vuitton : les jeunes de la génération Z, aux revenus plus modestes, se tournent vers des produits dits pingti, des répliques de haute qualité ou des imitations d’articles de luxe, vendues à des prix beaucoup plus bas.
Sponsored Content
Gucci

Tout comme Louis Vuitton, le succès de Gucci s'appuie sur ses modèles au monogramme iconique, perçus instantanément comme des signes extérieurs de richesse. Or, dans un contexte où étaler sa fortune est désormais mal perçu en Chine, et avec l’essor de la contrefaçon, Gucci se retrouve naturellement boudée par de nombreux consommateurs.
L’an dernier, le groupe Kering, maison mère de Gucci, Yves Saint Laurent et Balenciaga, a vu ses bénéfices chuter de 62 %, en grande partie à cause du ralentissement de la demande en Chine.
Avec Gucci qui représente la moitié du chiffre d’affaires du groupe et jusqu’à deux tiers de ses bénéfices, le redressement de la marque sera déterminant pour l’avenir de Kering.
Burberry

Burberry traverse une période tout aussi difficile. Réputée pour son célèbre motif à carreaux, la marque britannique de luxe a connu une forte baisse en Chine, son marché le plus important où elle compte 65 boutiques. Ses ventes y ont chuté de 19 % par rapport à 2023.
Perçue comme trop chère, la marque a suscité la polémique lorsqu’une bouillotte vendue 460 dollars (420 euros) est devenue virale sur Weibo, déclenchant le hashtag #Burberry ne recevra pas un centime de moi.
Toutefois, il y a une lueur d’espoir : les consommateurs chinois fortunés préfèrent désormais acheter leurs articles de luxe au Japon, profitant de la faiblesse du yen. Pendant ce temps, le nouveau PDG espère renverser la tendance et relancer la marque.
Hugo Boss

Hugo Boss subit le même sort que Burberry. En novembre, la maison de mode allemande a confirmé qu’elle ne pourra pas atteindre ses objectifs de ventes et de bénéfices pour 2025, en partie à cause du ralentissement de la demande en Chine. Parallèlement, elle a annoncé une baisse de 7 % de son chiffre d’affaires trimestriel en Asie-Pacifique.
Mais toutes les marques de luxe ne sont pas en difficulté en Chine. Hermès, Prada et Ralph Lauren ont enregistré une hausse de leurs revenus. Contrairement à d’autres enseignes plus ostentatoires, ces maisons incarnent le concept de « quiet luxury , un luxe discret et raffiné. Un positionnement qui leur permet de mieux résister au rejet croissant de la consommation ostentatoire dans le pays.
Sponsored Content
Omega

Dans le secteur du luxe, les marques horlogères occidentales haut de gamme comme Omega traversent une période difficile en Chine, malgré de bonnes performances ailleurs dans le monde. Dans l’Empire du Milieu, afficher une montre coûteuse n’est plus vraiment de mise.
Au second semestre 2024, le Swatch Group, propriétaire d’Omega, a enregistré une chute de 30 % de ses ventes dans la grande région chinoise incluant Hong Kong et Macao. La part de ce marché dans l’activité globale du groupe est également passée de 33 % à 27 % en un an. Face à cette baisse de la demande, la production a été réduite de 20 %.
Toutefois, un élément positif se dessine : les ventes des marques plus abordables du groupe, comme Swatch et Tissot, pourraient mieux résister. Les consommateurs chinois semblent en effet privilégier des montres plus accessibles et moins ostentatoires.
Tesla

Les ventes de Tesla en Chine, son deuxième plus grand marché, traversent une période de fortes turbulences. En février 2025, le constructeur américain de véhicules électriques a livré près de 50 % de voitures en moins par rapport à la même période en 2024, selon les chiffres de la China Passenger Car Association.
Si le ralentissement économique chinois pèse sur Tesla, la concurrence locale représente une menace encore plus grande. Le géant chinois BYD, premier constructeur automobile du pays et principal rival de la marque américaine, ne cesse de gagner du terrain et semble remporter la guerre des prix qui fait rage sur le marché. Dernière offensive en date : l’intégration de fonctionnalités d’assistance à la conduite intelligente même sur ses modèles les moins chers, poussant d’autres fabricants chinois à suivre cette tendance. Tesla propose aussi des technologies avancées, mais à des prix bien plus élevés, ce qui le désavantage face à ses concurrents locaux.
Un autre obstacle vient de l’image d’Elon Musk. Les prises de position politiques du patron de Tesla agacent certains clients chinois, notamment à un moment où son allié Donald Trump cible la Chine avec de nouvelles sanctions commerciales.
Volkswagen

Volkswagen connaît aussi des difficultés en Chine, son marché le plus rentable, qui représente un tiers des ventes du groupe. L’an dernier, ses ventes y ont chuté de 10 %, les constructeurs locaux surpassant la marque allemande en prix, innovations et attractivité auprès du public chinois.
La situation est particulièrement préoccupante pour sa gamme électrique. En janvier, une version de son modèle ID7 ne s’est vendue qu’à neuf exemplaires, soit une chute de plus de 96 % sur un an. Un chiffre sans doute exceptionnel, mais qui a dû ébranler les dirigeants du groupe.
Volkswagen ne compte pas abandonner la partie. La marque a annoncé un partenariat avec CATL, le plus grand fabricant de batteries chinois, pour développer des batteries moins coûteuses et explorer la technologie du swap de batteries, qui pourrait permettre d’éviter les longues recharges. En parallèle, le constructeur prévoit de lancer une voiture électrique économique pour rivaliser avec la concurrence chinoise bon marché, y compris sur le marché européen.
Premier constructeur automobile mondial en chiffre d’affaires, Volkswagen a une carte maîtresse à jouer. S’il échoue à s’imposer en Chine, l’avenir s’annonce encore plus incertain pour ses rivaux.
Sponsored Content
General Motors

General Motors est un autre constructeur occidental qui lutte pour préserver sa part de marché en Chine. Le groupe opère dans le pays en partenariat avec SAIC, mais cette coentreprise a accusé une perte de 347 millions de dollars (317 millions d’euros) sur les neuf premiers mois de 2024.
En décembre dernier, GM a averti ses actionnaires d’une dépréciation d’actifs dépassant les 5 milliards de dollars (4,5 milliards d’euros), incluant des coûts de restructuration et une réévaluation à la baisse de ses activités en Chine.
Dans le cadre de cette restructuration, le groupe prévoit notamment de fermer une usine à Shenyang. Plutôt que de poursuivre sa bataille sur le marché de masse, GM mise désormais sur le haut de gamme et le luxe, en se recentrant sur des marques comme Cadillac et Buick. Autrement dit, vendre moins, mais à des prix plus élevés.
Un pari audacieux sur un marché automobile chinois de plus en plus sensible aux prix, où les préférences des consommateurs évoluent rapidement.
Toyota

Toyota peine à traverser la crise économique et à tenir tête à la concurrence locale en Chine, où sa part de marché recule. L’an dernier, le constructeur japonais a écoulé près de 1,8 million de véhicules dans le pays, faisant de la Chine son deuxième marché après les États-Unis. Pourtant, malgré ce volume impressionnant, ses ventes ont chuté de 6,9 %.
Son retard sur le marché des véhicules électriques explique en partie ce déclin, alors que les constructeurs chinois inondent le marché de modèles abordables. Mais Toyota pourrait aussi payer le prix d’un boycott des produits japonais par les consommateurs chinois, déclenché par le rejet d’eau contaminée de Fukushima dans l’océan Pacifique en 2023.
Pour tenter de redresser la barre, le premier constructeur automobile mondial en volume prévoit d’ouvrir une usine Lexus dédiée aux véhicules électriques à Shanghai en 2027. Une initiative stratégique pour renforcer sa présence sur le marché chinois.
Intel

En mars 2024, les fabricants étrangers de semi-conducteurs ont subi un revers lorsque le gouvernement chinois a interdit l'utilisation de puces fabriquées à l'étranger dans ses ordinateurs et serveurs. Parmi les entreprises les plus touchées par cette interdiction figure Intel. L'an dernier, le géant américain a généré 15,5 milliards de dollars (14,1 milliards d’euros) en Chine, soit 29 % de son chiffre d'affaires mondial.
Dans le même temps, Washington a renforcé ses restrictions à l'exportation, avec de nouvelles mesures potentiellement en préparation. De son côté, Pékin pourrait riposter en ouvrant une enquête antitrust contre Intel, perçue comme une réponse aux droits de douane imposés par Donald Trump.
Face à ces obstacles en Chine, le groupe mise désormais sur l'expansion de ses opérations aux États-Unis, une stratégie qui apparaît judicieuse au vu des tensions croissantes.
Sponsored Content
AMD
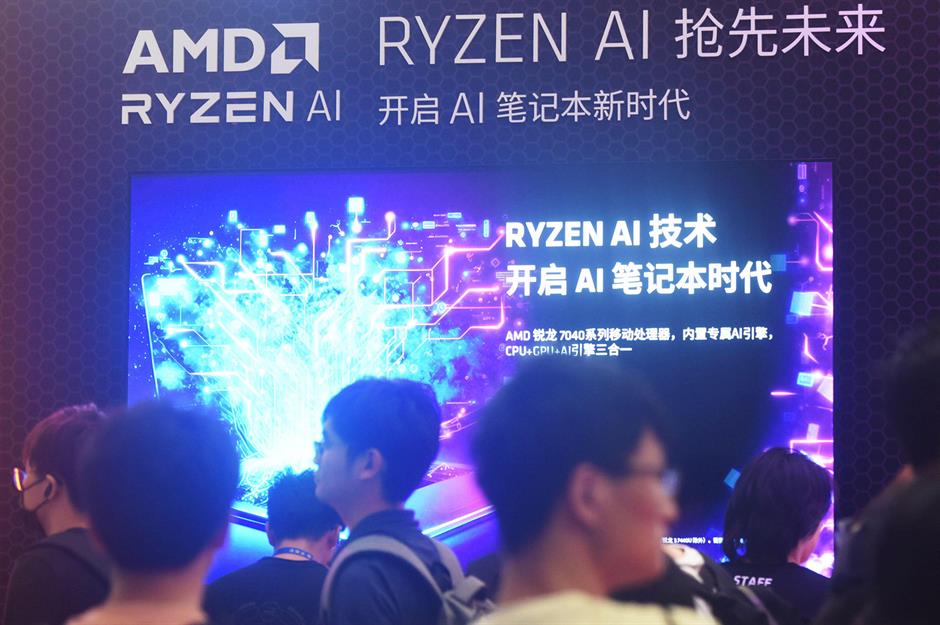
La Chine est également un marché clé pour AMD, autre fabricant américain de semi-conducteurs. En 2023, la Chine représentait 15 % de son chiffre d’affaires mondial, qui s’élevait à 22,7 milliards de dollars (21 milliards d’euros).
Comme Intel, AMD est au cœur de la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine. Des restrictions de plus en plus sévères frappent les deux camps, l’Amérique cherchant à limiter l’accès de la Chine à la technologie avancée des semi-conducteurs, tandis que la Chine exclut les fabricants de puces américains. Ces réglementations strictes ont fait chuter les actions des deux entreprises, et leur situation risque de s’aggraver si elles sont davantage entravées dans leurs activités en Chine.
Apple

Les déboires d’Apple en Chine semblent sans fin. Le ralentissement économique du pays a pesé sur les ventes des produits haut de gamme du géant américain, tandis que les fabricants locaux lui grignotent des parts de marché. En septembre, le lancement de l’iPhone 16 a été éclipsé en quelques heures à peine par la sortie d’un nouveau smartphone tri-pliant signé Huawei. Depuis, et sur un marché du smartphone en perte de vitesse, même l’iPhone 16e, plus abordable, semble avoir reçu un accueil mitigé.
Pour relancer ses ventes, Apple a misé sur des rabais, mais d’autres défis de taille l’attendent, notamment la manière de contourner l’interdiction chinoise de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, qui pourrait encore freiner ses ventes. L’entreprise a récemment annoncé un partenariat avec Alibaba pour tenter de résoudre le problème.
La Chine est le troisième plus grand marché d’Apple. Elle représentait 17 % de son chiffre d’affaires l’an dernier. La baisse des ventes est donc une mauvaise nouvelle pour la firme, d’autant qu’elle subit aussi de plein fouet la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Apple a ainsi entrepris de délocaliser une grande partie de sa production hors de Chine, une décision qui risque d’être coûteuse.
Vous avez aimé ce contenu ? Ajoutez un like et cliquez sur le bouton Suivre en haut de la page pour découvrir d’autres articles de loveMONEY.
Comments
Be the first to comment
Do you want to comment on this article? You need to be signed in for this feature